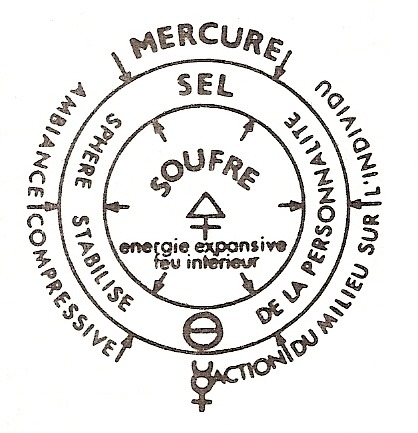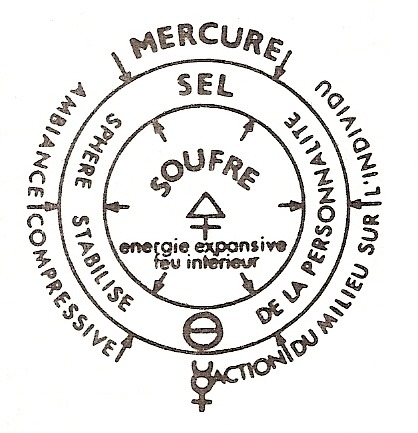
Depuis le “siècle des lumières” à aujourd’hui, nous avons pris la mauvaise habitude de considérer l’alchimie comme une forme primitive de la chimie contemporaine. Aussi la plupart des chercheurs qui se sont intéressés à sa littérature n’y ont vu que les toutes premières étapes de découvertes chimiques postérieures.
Reconnaissons que cette littérature nous transmet certaines expériences artisanales concernant la préparation des métaux, du verre et des couleurs, lesquelles l’on peut parfois reconstituer à l’aide de la technologie moderne.
L’alchimie proprement dite, cependant, ce que l’on appelle le “Grand Œuvre” décrit par ce qu’il convient d’appeler les auteurs hermétiques, se situe sur un tout autre plan ; et, malgré les expressions métallurgiques dont ces auteurs se servent, la nature des opérations ne se laisse guère identifier chimiquement.
Du point de vue de la science moderne, ces opérations ne sont pas seulement aberrantes, mais franchement absurdes. En découle, que l’on a conclu qu’un insatiable désir de fabriquer de l’or a plongé ces alchimistes, qui étaient au demeurant de raisonnables orfèvres, verriers où teinturiers, en une recherche parfaitement chimérique, où des phantasmagories se mêlaient à un empirisme trop naïf.
Or, si cela était le cas, nous devrions admettre que l’œuvre alchimique présente à chaque pas l’arbitraire, et qu’elle soit composée d’improvisation. Pourtant il n’en est rien ; le magistère des alchimistes comporte un certain principe d’unité ; loin de se présenter comme une vague aventure, il possède tous les caractères d’un “art”, à savoir une doctrine et une méthode transmise de maître à élève et les caractéristiques générales, pour autant que l’on puisse en juger à travers les descriptions symboliques, sont les mêmes de l’antiquité à aujourd’hui et de l’occident à l’extrême orient.
Qu’un art foncièrement absurde soit capable, malgré d’innombrables échecs et déceptions, de se maintenir avec une telle continuité au sein des civilisations les plus diverses, est un fait dont le caractère improbable semble n’avoir frappé personne. Nous devons donc admettre, soit que les alchimistes, dans leur désir de se tromper eux-mêmes, ont patiemment cultivé un mythe mille fois démenti par la nature, soit que leur expérience effective se plaçait sur un autre plan de réalité que celui dont s’occupe notre science empirique moderne.
Logiquement, les deux alternatives s’excluent. Ce n’est pas l’avis de la moderne “psychologie des profondeurs”, qui propose de trouver dans le symbolisme alchimique une confirmation de sa propre thèse de l’”inconscient collectif”. D'après cette thèse, l’alchimiste, dans sa recherche comparable à un rêve, projette certains contenus de son âme, jusqu’alors ignorés de lui-même, et de fait, sans en avoir l’intention, opère une sorte de réconciliation entre la conscience quotidienne superficielle et la puissance latente de l’”inconscient collectif”.
La réconciliation du conscient et de l’inconscient donnerait naissance à une expérience intérieure tenant lieu du magistère auquel l’alchimiste aspirait. Ce point de vue, est également fondé sur l’hypothèse que l’intention initiale de l’alchimiste serait de fabriquer de l’or. Il est donc considéré comme emprisonné dans une sorte de délire ou dupe de sa propre “projection” imaginative, et en conséquence comme pensant et agissant comme en état de rêve.
Bien que cette explication ait quelque chose de séduisant, il n’en reste pas moins que nous devons nous souvenir que la réalité spirituelle, que l’œuvre alchimique doit dégager, est une chose dont le novice est relativement inconscient. Il s’agit d’une réalité profondément cachée dans l’âme. Néanmoins, cette “profondeur secrète” ne doit en aucun cas être confondue avec le chaos du soi-disant “inconscient collectif”.
La “fontaine de jouvence des alchimistes ne jaillit nullement d’un obscur fond psychique ; elle coule de la source de toute vérité intemporelle. Elle est cachée à l’alchimiste au début de son œuvre, simplement parce qu’elle se situe, non pas au-dessous des phénomènes de sa conscience ordinaire, mais à un niveau bien supérieur.
La proposition des psychologues s’évanouit lorsque l’on réalise que les véritables alchimistes ne furent jamais emprisonnés dans quelque rêve cupide de fabrication de l’or, et qu’ils ne poursuivaient pas leur objectif comme des somnambules. Ils suivaient, au contraire, une méthode bien étudiée, exprimée symboliquement en termes de métallurgie - art de transmutation des métaux vils en argent ou en or – et c’est évidemment cela qui a égaré bien des chercheurs non initiés ; pourtant cette expression est en elle-même logique et même, réellement profonde.
A suivre.....
Jean-Claude Thimoléon
(introduction de mon ouvrage sur l'alchimie)
© Jean-Claude THIMOLÉON JOLY
reproduction intégrale interdite, tout extrait doit citer mon site www.theraneo.com/thimoleon
Mots clés : alchimie, vision, contemporaine, chimie,
Autres articles de cette rubrique | voir tous